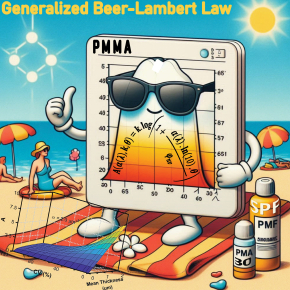Un indice de protection solaire plus complexe qu’il n’y paraît
L’indice de protection solaire ne dépend pas uniquement de la formule chimique d’une crème solaire, mais également de la manière dont elle s’étale et adhère à la peau. Jusqu’alors, cet indice était obtenu par des tests in vivo réalisés sur des volontaires humains ce qui pose des problèmes éthiques et pratiques (risques de cancer, coût…). Des scientifiques viennent de mettre au point des expériences in vitro prometteuses permettant d’améliorer la fiabilité et la compréhension de ce type de tests.
L’indice de protection d’un produit solaire était jusqu’à présent déterminé en exposant la peau de volontaires à des doses croissantes de rayonnements UV jusqu’à l’apparition des premières rougeurs. Bien que ces tests in vivo servent à établir depuis des décennies l’indice de protection des produits commerciaux, ils posent de nombreux problèmes. Ethiques tout d’abord, car exposer des personnes à des rayonnements potentiellement cancérigènes est discutable, mais aussi car ces tests sont coûteux et chronophages. Enfin, d’un point de vue réglementaire, les restrictions croissantes en matière d’expérimentations in vivo compromettent leur avenir à moyen terme.
Pour contourner ces difficultés, des scientifiques du Centre de recherche Paul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) travaillent sur l’amélioration des tests, in vitro cette fois, réalisés sur des substrats en plastique. Une méthode peu coûteuse donnant rapidement des résultats, mais pour laquelle les scientifiques peinent encore à reproduire les valeurs obtenues in vivo.
En utilisant des substrats de rugosités variables qui se rapprochent de celles de la peau, les chercheurs ont étudié la corrélation entre les résultats vivo et vitro. L’étude par photographie UV et spectroscopie du comportement de la crème solaire sur des plaques de différentes rugosités leur a permis de montrer que la crème forme un film mince à la surface du substrat dont la texture, l’épaisseur et l’homogénéité influencent fortement l’efficacité. Pour la première fois, en adaptant à ces films inhomogènes la loi de Beer-Lambert qui décrit comment la lumière est absorbée lorsqu’elle traverse une substance, ils ont établi un lien analytique entre l’absorbance, la distribution d’épaisseur, l’homogénéité du film, et l’efficacité de la protection. Ce modèle validé sur 3 crèmes solaires explique la mauvaise corrélation entre les résultats obtenus in vitro et in vivo pour les forts indices. C’est aussi un grand pas de franchi vers la compréhension de la variabilité en fonction du type de produits solaires (stick, crème, lait, spray).
Ces travaux publiés dans la revue ACS Applied Materials & Interfaces, montrent à quel point les propriétés des films formés sur la peau par les crèmes solaires influencent leur efficacité. Ces résultats sont cohérents avec la nouvelle norme vitro publié en décembre 2024 qui permet désormais l’utilisation des seuls tests vitro pour la revendication de l’indice de protection. Cette approche devrait permettre une généralisation à tous les types de galéniques et ainsi obtenir un indice de protection toujours plus fiable correspondant à ce qui est réellement observé sur l’humain.
Rédaction : CCdM
Référence
Etienne Lepoivre, Sylvain Auge, Frederic Nunzi, Philippe Cluzeau & Jean-Paul Chapel
Generalized Beer−Lambert Law for Evaluating the Absorption of Heterogeneous Sunscreen Films
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c02458