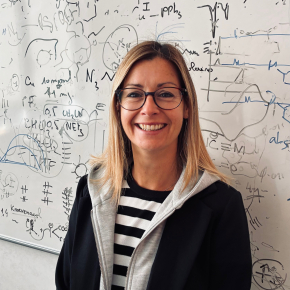Clémence Queffélec, récompensée sur la route du bio-bitume
Lauréate du Grand Prix Arkema 2025, Clémence Queffélec - maîtresse de conférences au laboratoire Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation (CEISAM)1 - s’attaque à un défi peu visible mais colossal : trouver une alternative durable au bitume pétrolier en donnant une seconde vie à nos déchets.
- 1Unité CNRS/Université de Nantes
Produit de la distillation des pétroles lourds, le bitume est une « mélasse noire » aux propriétés thermo-visco-élastiques remarquables. Il permet, entre autres, d’assurer la cohésion d’un édifice granulaire et est ainsi employé pour produire des enrobés routiers. Toutefois, sa production reste dépendante des stratégies de raffinage qui varient en fonction du prix du baril et des stocks de pétroles lourds. Le risque de pénurie de cette ressource fossile épuisable est également non négligeable à moyen terme alors qu’en France, nous en consommons entre deux et trois millions de tonnes par an. « Il nous faut trouver des alternatives crédibles et compétitives, à la fois pour réduire notre dépendance et pour limiter les émissions de CO₂ associées », souligne Clémence Queffélec, spécialiste en chimie des matériaux à l’université de Nantes.
Les premiers travaux de la chercheuse sur le sujet démarrent en 2010. Ils explorent alors une idée séduisante : mimer la formation du pétrole à partir de micro-algues. Transformés à pression et température élevées, leurs résidus donnent un liquide sombre aux propriétés proches du bitume. Mais la filière, trop gourmande en eau, n’a jamais atteint la masse critique nécessaire à une industrie de millions de tonnes.
L’équipe s’est alors tournée vers des déchets plus abondants : les huiles alimentaires usagées qui sont naturellement hydrophobes, comme le bitume. « L’idée est de créer un cycle vertueux : ces huiles sont aujourd’hui brûlées, donc sources de CO₂. En les intégrant dans les routes, on stocke du carbone tout en leur donnant une seconde vie », explique la chercheuse. L’objectif ? Les rendre plus visqueuses et stables. Le défi est relevé avec succès en associant aux huiles de la biomasse lignocellulosique issus de déchets du bois et de l’industrie papetière.
Toutefois, le chemin vers le transfert de cette solution est encore long et semé d’embûches. Sur le plan économique, les procédés doivent rester compétitifs face à un bitume fossile peu coûteux, bien que l’analyse de cycle de vie montre un bilan carbone négatif pour le bio-bitume. Sur le plan technique : stabilité dans le temps, formulation d’émulsions utilisables à basse température, compatibilité avec les installations existantes… Bref, des tests sont menés avec les industriels Colas et Eiffage afin d’évaluer la faisabilité de leur intégration. « Pour autant, nous n’avons pas besoin de remplacer 100 % du bitume, souligne Clémence Queffélec. Comme pour l’essence E10, on peut imaginer 5 à 20 % de bio-bitume dans le recyclage des routes, ce qui devient compétitif et réaliste ».
Au-delà des applications, l’intérêt scientifique reste immense allant de la compréhension de la structure complexe du bitume à l’exploration de voies inédites comme la transformation de la lignine. « La recherche sur ce sujet est infinie, confie la chercheuse. Chaque nouvelle contrainte – normes, régulations, coûts – ouvre de nouvelles pistes ce qui rend ce travail passionnant ». Prochaine étape ? Stabiliser la formulation pour se rapprocher petit à petit d’un usage routier concret.
La chercheuse est aujourd’hui récompensée pour ces travaux par le Grand Prix Arkema 2025. Mais Clémence Queffélec y voit surtout une reconnaissance collective : « Je travaille avec Emmanuel Chailleux, spécialiste de la physico-chimie des matériaux routiers à l’université Gustave Eiffel, et c’est la complémentarité de nos approches qui nous permet d’avancer ». Une récompense qui, elle espère, renforcera encore les liens entre académiques et industriels pour continuer à bâtir, pierre par pierre… ou plutôt caillou par caillou, les bio-routes de demain.
Rédacteur : AC